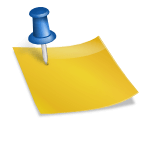Le mot caste n’est nullement le synonyme de classe, ni le produit de préjugés de race qui sont caractéristiques des peuples occidentaux et démocratiques! Il est très intéressant de constater que dans l’Inde moderne, où les puissances dirigeantes furent très loin d’être exemptes du préjugé de races, mais s’efforcèrent, par contre, d’ignorer le système des castes, des distinctions de classe étaient faites dans les services administratifs et déterminées par les différences de salaires ; l’exclusivisme social s’est fortement développé comme c’est le cas quand des hommes sont capables de faire le même genre de travail, mais gagnent des salaires différents selon leur « grade ». Il est non moins intéressant de constater que, dans ces mêmes services, existe une discrimination par quota contre les Brahmanes, de crainte qu’ils n’ « usurpent » grâce à leurs hautes capacités intellectuelles les postes les plus brigués, attitude comparable à celles des Américains qui fixent des quota contre les Juifs et font naître ainsi un sentiment de classes rivales dans un pays où il n’y en avait jamais eu auparavant.
Peut-être demanderez-vous : « Comment peut-on appeler travail choisi un travail qui est imposé? » Et tout d’abord, comment est-il imposé? Nous ne devons pas négliger la conception traditionnelle selon laquelle le père, en ce qui concerne sa personnalité empirique ou « caractère », revit dans son fils, lequel s’identifie à lui sous tous les rapports et prend sa place dans la communauté lorsqu’il s’en retire ou après sa mort, et cette transmission naturelle est confirmée par les rites formels de la transmission. La fonction héréditaire est une forme du service divin et le métier (c’est-à-dire le ministère), un travail qui en même temps honore Dieu et satisfait les besoins actuels de l’homme. C’est ainsi que dans l’Inde, comme chez Platon, la première raison pour laquelle on « doit » procréer est qu’il faut transmettre de génération en génération le « bon travail » [[Voir références dans mon « Hinduism and Buddhism », p. 41, n. 146, à Shatapatha Brahmana, 1, 8, 1, 30, 31 ; Philon, Conf., 94 ; Dec, 119, etc..]] afin que, comme le dit le Livre de la Sagesse, nos descendants puissent « maintenir le système du monde » (Ecclésiaste, xxxviii, 34), « notre ordre social ». En second lieu, c’est un fait, l’Hindou qui n’est pas corrompu par l’idée d’ « ascension » sociale n’est jamais honteux de sa profession; il en est fier, au contraire.
C’est en s’inspirant de ce point de vue que Hocart pouvait dire que dans l’Inde « chaque occupation est un sacerdoce » [[A. M. Hocart, Les Castes, p. 27]].
Dans la Gita, vous avez peut-être remarqué ce passage : « C’est autant par son travail que par ses prières qu’il chante Ses louanges. » Ainsi le travail est une sorte de liturgie et Laborare est orare, ou, comme dit le Livre de la Sagesse : « Leur prière se confond avec le travail de leurs mains. » [[Ecclésiaste, XXXVIII, 34; Saint Thomasd’Aquin, Summa contra Gentiles, III, 135. « Homo autem ex spirituali natura conditus est. Necessarium est igitur secundum dividam ordinationem, ut et corporales actiones exerceat et spiritualibus intendat : et tanto perfectior est’ quanto spiritualibus intendit. »]]. Tous les peuples dont le travail n’a pas été organisé en vue d’un profit ont toujours chanté en accomplissant leur tâche et, bien souvent, le contenu de ces chansons est religieux ou métaphysique : mais dans les sociétés « civilisées », c’est-à-dire mécanisées, ces chansons ne subsistent que sous la forme de divertissements de salon avec accompagnement de piano. Le mal que l’urbanisme a fait aux cultures traditionnelles et à leurs manufacturiers (au sens littéral et propre du mot), il l’a fait en premier lieu aux travailleurs : « Nous leur avons enlevé la possibilité de réaliser des chefs-d’œuvre. Nous avons effacé dans leurs âmes le besoin de la qualité pour ne leur laisser désirer que la quantité et la vitesse. » [[Jean Giono, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, 1938.
« Quand les nations vieillissent, les arts se flétrissent et le commerce s’installe à chaque coin de rue » (William Blake). « Aujourd’hui la machine est devenue une chose terrifiante. On la voit partout j dans les champs, dans les fermes, dans les bureaux, dans les magasins, dans les usines. Et partout où elle se trouve, l’humanité est plongée dans les ténèbres du chômage et de la sous-consommation » (R. D. Knowles, Britain’s Problem, 1941).
« Le travail de l’homme, aussi, a cessé de lui apporter un soutien spirituel, il n’est jamais seul en présence de tâches rendues plus chères par un travail lent et pénible, qui dure parfois des années ou même toute une vie… Ainsi le contact personnel, qui fait naître une intimité presque religieuse entre le travailleur et son travail, a été presque détruit, car la « chaîne mobile » ne permet qu’un contact impersonnel avec des milliers de pièces séparées d’un tout ; et le goût de l’artisan pour la qualité a été remplacé par celui de la quantité » (Betty Heimann, Indian and Western Philosophy, 1937, p. 134).
]].
Pouvez-vous imaginer des ouvriers d’usine se mettant en grève pour avoir le droit de prendre en considération la « bonté » du travail à effectuer et non pour avoir de plus gros salaires et une plus grande part des bénéfices patronaux?
Selon la doctrine chrétienne, le travailleur est « naturellement enclin par la justice » à prendre cette « bonté » en considération [[Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologica, II, II, 57, 3 ad 2]]. Si cela n’est pas, c’est parce que l’homme mécanisé, déterminé par les facteurs économiques et par conséquent irresponsable, a été dénaturé. Comme le dit le comte de Portsmouth : « C’est la richesse et le génie de notre peuple dans la variété, le caractère et l’habileté, que nous devons sauver maintenant. » [[Comte de Portsmouth, Alternative to Death, 1944, p. 30]]. Tout cela est, en partie, le prix qui doit être payé pour la poursuite sans fin d’ « un niveau de vie plus élevé », prix que tout « cobaye », doit payer pour l’insatiable avidité qu’entretient avec tant de succès le commerce moderne. Si la pauvreté consiste à n’avoir jamais assez, le monde industriel sera toujours dans le besoin.
La « sanctification du travail » a été désignée comme « l’apport le plus important du moyen âge au monde ». Il aurait mieux valu dire que c’est l’héritage d’un passé immense qui a été vendu pour une bouchée de pain et qui n’a plus aucune signification dans notre monde de « réalité appauvrie ». Du point de vue hindou, les castes sont, à la lettre, « nées du sacrifice », c’est-à-dire de la « Rupture du pain », sacrifice primordial de l’Un, que hommes et dieux ont rendu multiple et par conséquent aussi, du rituel qui reproduit le sacrifice originel et qui correspond à la Messe chrétienne. La Divinité qui est et qui accomplit le premier sacrifice, « qui se divise pour remplir le monde » par son omniprésence totale, s’appelle, en tant que Démiurge par qui toutes les choses sont faites : « Celui qui fait tout » Vishwakarma, et, en vérité, elle accomplit les actes divers, vishiva karmani, qui sont nécessaires pour célébrer le sacrifice de la Messe d’une façon parfaite. Mais l’individu, lui, n’est pas de même l’Homme de tous les métiers. « J’ai manifesté les quatre castes, dit Shrî Krishna, j’ai réparti les qualités et les tâches. » (Bhagavad Gita, IV, 13) « Il existe donc une diversité de fonctions bien qu’il n’y ait qu’un Dieu qui accomplit tout dans tous les êtres. » (I Cor., 12, 6)
VOIR EN SUITE: Les notions d’égalité et de liberté