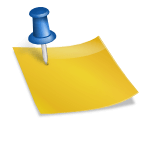Qui dit tradition, dit plénitude : si certaines religions n’ont pas de, langue sacrée, cela prouve, non qu’elle leur fait défaut, mais qu’elles n’en ont pas besoin, c’est-à-dire qu’elles compensent ce manque apparent par des éléments qui leur sont propres1. Le sens exprimé par la parole est indépendant du langage lui-même; cette indépendance doit donc se manifester quelque part, même si l’aspect contraire – la connexion entre le langage et son contenu – apparaît comme une norme relative2 : il doit y avoir des révélations qui ne fixent de la parole divine que le contenu et non le vêtement linguistique, et qui « remplacent », si l’on peut dire, la langue sacrée par d’autres supports immuables. (Frithjof Schuon, Perspectives spirituelles et faits humains PSFH)
Le Bouddhisme et le Christianisme possèdent chacun plusieurs langues liturgiques, mais qui ne sont pas la « chair » même de la révélation. Du reste, si on voulait voir là un manque, on devrait s’étonner tout autant du fait que l’Islam, contrairement à ce qui a lieu dans le Christianisme et le Judaïsme, n’exige aucun rite d’adhésion; la, circoncision n’y est pas une condition indispensable. ↩
D’une façon analogue, les castes même si elles sont naturellement inhérentes à toute collectivité intégrale, ne sauraient déterminer les individus d’une manière absolue, en sorte qu’il doit, y avoir des sociétés traditionnelles qui se placent à un autre point de vue, et même au point de vue inverse, celui de l’égalité des hommes devant Dieu, et qui de ce fait ignorent les classifications sociales. ↩