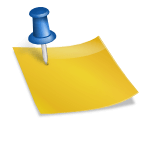- Sumário
- Original
Sumário
-**II – A perspectiva metafísica e o princípio de individuação
-***A Transcendência como interioridade absoluta. Transcendência, subjetividade e via negativa (Os fundamentos metafísicos da “individuação de interioridade”)
-****A noção de Absoluto que caracteriza a perspectiva metafísica repousa sobre uma concepção integral da Transcendência
-****A perspectiva metafísica supera a alternativa do idealismo e do realismo, não realiza no entanto plenamente a significação do Absoluto que ela visa, a não ser no quadro de uma via aparentemente subjetiva que se exprima essencialmente em termos de consciência e de interioridade
-****Em que sentido se poderia falar de uma individuação absoluta da Transcendência. O Absoluto metafísico é em um sentido o Indivíduo absoluto, que possui a indivisível plenitude da interioridade.
-****A interiorização que desemboca sobre a Transcendência absoluta coincide com uma negação integral, quer dizer uma superação ontológica concreta — e radical — de toda relatividade, de toda multiplicidade mesmo “interior”.
-****A teologia negativa é concebida no homem religioso em função de uma negação, quer dizer de uma transcendência mais intencional e abstrata que efetiva. A via negativa reveste por conseguinte na perspectiva religiosa duas funções essenciais:
-*****Sobre o plano “dialético” da teologia natural de Tomás de Aquino, por exemplo, ela aparece com o simples complemento da teologia catafática, destina a desembaraçar de sseua antropomorfismo as qualidades que esta atribui por analogia a Deus, quer dizer ao Absoluto pessoal.
-*****Sobre o plano “existencial” da “teologia mística” de São João da Cruz, o método negativo aparece a princípio como a recusa voluntária deste mundo à realidade substancial do qual o espiritual foi invencivelmente lavado a crer, logo a negatividade passional da angústia e das trevas da “noite” sanjuanista.
-***A imanência do Absoluto metafísico e a origem da negação. Significação e justificação metafísicas da “individuação pela matéria”
-****O aspecto positivo da individuação de exterioridade. A “Matéria inteligível”
-****O aspecto negativo da individuação de exterioridade. O Nada como Matéria não inteligível e a situação do “princípio” de individuação pela matéria
Original
La perspective métaphysique, op. cit., III Partie, chap. I. ↩
Cette supériorité se manifeste notamment dans l’application de la doctrine à la réalisation spirituelle. L’intériorité du Soi présupposée par la « théorie » védàntique est comme une invitation à réaliser, à « devenir » ce que je suis, tandis que « l’objectivité » de l’Un produit d’abord comme un réflexe de recul. ↩
Plotin dans un style occidental, parlera de l’Un ou du Bien plutôt que du Soi ou de la Non-dualité. ↩
Cf. Lacombe, L’Absolu selon le Vêdânta, p. 229 sq. ↩
Cf. « Comment discriminer le spectateur du Spectacle », Traité védântique, Ed. Maisonneuve. ↩
Cf. le ternaire classique : Être-Conscience-Béatitude (Sat-Chit-Ananda) qui est attribué par Shankara à l’aspect « transpersonnel » de l’Absolu. ↩
Soit conscience du « monde », soit conscience de soi. ↩
C’est cette dimension que semble avoir négligé Spinoza, tandis qu’elle n’est pas absente du néoplatonisme, malgré l’aspect « extatique » du « contact avec l’Un. ↩
Cet aspect d’actualité infinie de l’être implique évidemment l’aspect « d’éternité ». ↩
La théologie mystique de l’Église d’Orient nous parait réserver, grâce à son apophatisme, à celui qui est capable de dépasser les exigences passionnelles de la conscience religieuse, la possibilité d’une compréhension proprement métaphysique des « mystères » de la Trinité. ↩
On sait que l’apophatisme de la perspective métaphysique se traduit par l’emploi de termes à structure négative pour désigner l’Absolu métaphysique : Non-dualité védantique, Non-agir taoïste, Non-Etre guénonien, etc. (cf. La perspective métaphysique, op. cit., IRE Partie, chap. II). ↩
Nous avons montré ailleurs comment cette extrême rigueur est jointe à une absence de dogmatisme. La perspective métaphysique n’est pas un système. C’est là ce qui nous paraît distinguer très profondément Platon, Plotin ou Shankara d’un philosophe comme Spinoza, qui se rapproche pourtant de leur perspective par bien des aspects de son système. ↩
Hegel l’a fait avec plus d’audace, mais moins de subtilité que le métaphysicien « pur ». ↩
Il est au moins curieux de noter à cet égard que Parménide, malgré son » Eléatisme » est plus proche d’Aristote que de Platon. Son monisme théorique est un dualisme de fait comme celui d’Aristote. Platon n’est rien moins que « dualiste », sinon pour des raisons de méthodologie spirituelle. ↩
Cette coïncidence des opposés est la marque même du véritable Infini, de l’Infini métaphysique. Si elle dépasse la raison, c’est à la manière dont l’Absolu transcende concrètement la manifestation, non en l’excluant, mais en l’intégrant. ↩
Nécessité et contingence sont des catégories qui sont antinomiquement dépassées au niveau de l’Absolu métaphysique : le « nécessitarisme » massif et dogmatique du vocabulaire spinoziste justifiait l’affirmation non moins passionnelle et dogmatique de la « liberté » divine chez ses adversaires « créationnistes ». ↩
Il s’agit ici de ce qu’on pourrait appeler une nécessité de perfection. ↩
On pourrait montrer comment la théorie émanatiste de Spinoza introduit en Dieu une limitation analogue à celle qu’il reprochait au créationnisme. Du point de vue de la perspective métaphysique, l’opposition n’est pas entre Monisme et Dualisme, mais entre non-dualisme métaphysique et ontothéologie dogmatique (Aristote, saint Thomas, Spinoza). ↩
Exprimée sous la forme la plus rigoureuse qui convienne à la « théologie négative » de la perspective métaphysique, à savoir l’apophatisme lié à l’anti-nomisme (ni différent, ni non-différent). ↩
L’émanatisme rejoint à cet égard la limitation du créationnisme. ↩
Cf. Plotin, Enn., II, 4, 5 : « Non que cette indéfinité soit dans l’Un, mais il (la) crée. » ↩
Ce que nous appelons l’individuation d’intériorité n’est donc désigné qu’improprement par cette expression. Il s’agissait plutôt du principe d’intériorisation. Mais la possibilité même d’employer légitimement cette dernière est un signe de l’ambiguïté de cette notion fondamentale, qui ne fait que refléter l’ambiguïté du principe métaphysique d’individuation lui-même, de ce Néant, de cette « Matière » ou de cette « Maya », qui est à la fois la puissance ténébreuse qui éloigne (illusoirement) de l’Absolu (individuation d’extériorité) et la puissance attractive qui ramène à lui la manifestation (individuation d’intériorité). ↩
Cf. Ennéades, II, 4, 5. ↩
C’est ce qui explique l’interprétation unilatérale mais tout à fait valable que fait le théiste Ramanuja de la Maya védantique, et qu’on retrouve aussi dans la « puissance merveilleuse » qui circule, dans l’intelligibilité dont parle Plotin in Enn., II, 9, 8. ↩
Par opposition à l’aspect « négatif » qui s’épanouira au maximum dans le temporalisme nihiliste d’un Sartre. ↩
Cette analyse nous aide à comprendre qu’il n’y a pas d’essence pure de toute « matière », sinon la racine « essentielle » de toutes les essences, qui se situe elle-même « au delà de l’essence », selon la formule de Platon. La perspective métaphysique non retenue par des contraintes sentimentales, nous conduit donc à reconnaître que Dieu, en tant que « créateur » du monde, est matériel à quelque degré. ↩
D’où la théorie plotinienne des « Idées des Individus ». Cf. Enn., V, 7. ↩
En d’autres termes il n’y a de véritable intégration de l’indéfini que par une coïncidence paradoxale entre l’immanence absolue et la transcendance absolue. Ce n’est qu’à ce prix que la logique selon l’entendement d’Aristote peut être réellement dépassée. C’est Plotin ou Nicolas de Cues qui dépasse réellement la logique d’Aristote, et non Leibniz ou Hegel. ↩
Selon l’expression de M. de Gandillac, in Œuvres choisies, de N. de Cues, p. 38 (édit. Aubier). ↩
Si Plotin ne parle guère de la matière intelligible dont il craint de divulguer les « secrets », il a du moins une nette conscience de l’ambiguïté de Maya, puisqu’il nous parle de « deux matières » (Enn., II, 4). ↩
L’unité profonde de la « voie de la connaissance » de la sagesse védântique tient à l’impossibilité de séparer ces deux aspects : le dépassement exige la connaissance, la connaissance est l’instrument par excellence de ce dépassement, de cette transascendance métaphysique qui est une intégration non seulement pensée mais effectuée ou réalisée. ↩
Elle n’est atteinte, comme dit Platon, que par un raisonnement bâtard (cf. Timée, loc. cit.). ↩
Cf. Guenon, L’homme et son devenir selon le Vêdanta, p. 45 sq. (Les Editions traditionnelles). ↩
Cf. Commentaires de Shankara à la Mandukyopanisad (Ed. Adyar). ↩